C’est un petit rituel auquel les Français sont très attachés. Chaque 1er mai, sur les marchés ou aux coins des rues, on s’échange un brin de muguet. Symbole de bonheur et de renouveau, cette fleur aux clochettes blanches est devenue l’emblème d’une journée particulière, mêlant célébration du printemps et Fête du Travail.
Mais quelle est l’origine de cette tradition ? Pourquoi offre-t-on du muguet le 1er mai ? Retour sur l’histoire de cette coutume populaire !
Du roi Charles IX aux premiers brins porte-bonheur

Comme pour beaucoup de traditions, les origines de la « fête du muguet » sont assez floues. Dès la Rome antique, on fêtait la période des floraisons vers fin-avril / début-mai mais il faut remonter au XVIe siècle pour trouver les premières traces d’un lien entre le muguet et les vœux de bonheur.
Le 1er mai 1560, le jeune roi Charles IX (1550-1574) aurait reçu un brin de muguet lors d’une visite dans la Drôme. Séduit par la délicatesse de cette attention et le parfum de la fleur, il décide d’en faire une coutume : chaque 1er mai, il offrira désormais un brin de muguet aux dames de la cour. Le geste est apprécié et perdure dans les cercles aristocratiques, avant de gagner peu à peu les couches populaires. Le muguet devient alors une fleur associée au printemps, au charme discret et à la chance.
Le 1er mai, une date entre lutte sociale et fleur blanche
Sous la Révolution, le muguet n’est plus associé au 1er mai mais au « jour républicain » qui correspond au 26 avril (7 Floréal dans le calendrier républicain). Le 1er mai est alors associé à l’églantine rouge qui devient aussi le symbole des travailleurs.
En 1889, les mouvements ouvriers du monde entier choisissent le 1er mai comme journée internationale des travailleurs, en hommage aux grèves sanglantes de Chicago trois ans plus tôt. En France, on défile alors avec une églantine rouge à la boutonnière, symbole de la lutte sociale.
Mais en 1941, sous le régime de Vichy, le maréchal Pétain cherche à effacer les symboles révolutionnaires. L’églantine qu’il juge trop associée à la gauche et au communisme, est remplacée par le muguet, jugé plus neutre. Cette année-là, le 1er mai devient officiellement la « Fête du Travail et de la Concorde sociale », et le muguet entre définitivement dans la tradition populaire de ce jour férié.

Découvrez d’autres anecdotes culturelles
Cette histoire vous plait ? Retrouvez d’autres petites histoires dans la rubrique anecdotes culturelles !
La vente du muguet : un privilège du 1er mai
Fait unique dans l’année : le 1er mai, il est autorisé de vendre du muguet sans déclaration préalable ni taxe alors qu’en principe toute vente de rue est soumise à autorisation. Il convient cependant de respecter certaines règles comme :
- vendre en petite quantité
- ne vendre que du muguet sauvage cueilli dans les bois
- ne pas nuire un commerce local en s’installant par exemple près d’un fleuriste
- ne pas être un danger pour les piétons ou les véhicules
- ne pas utiliser de table ou chaise matérialisant un point de vente
Ce privilège contribue à la dimension conviviale de la tradition. Scouts, enfants, associations ou simples particuliers profitent de l’occasion pour vendre quelques brins cueillis en forêt ou préparés avec soin.
Aujourd’hui, près de 60 millions de brins sont vendus chaque année en France à cette occasion, dont une grande partie provient de la région nantaise qui assure 85% de la production.
Une tradition vivante et bien enracinée
Bien que ses origines mêlent plusieurs influences — royale, militante, commerciale —, le muguet du 1er mai reste profondément ancré chez les Français. Offrir un brin de muguet, c’est souhaiter du bonheur, célébrer le retour des beaux jours… et perpétuer une tradition vieille de plusieurs siècles.
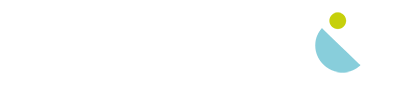
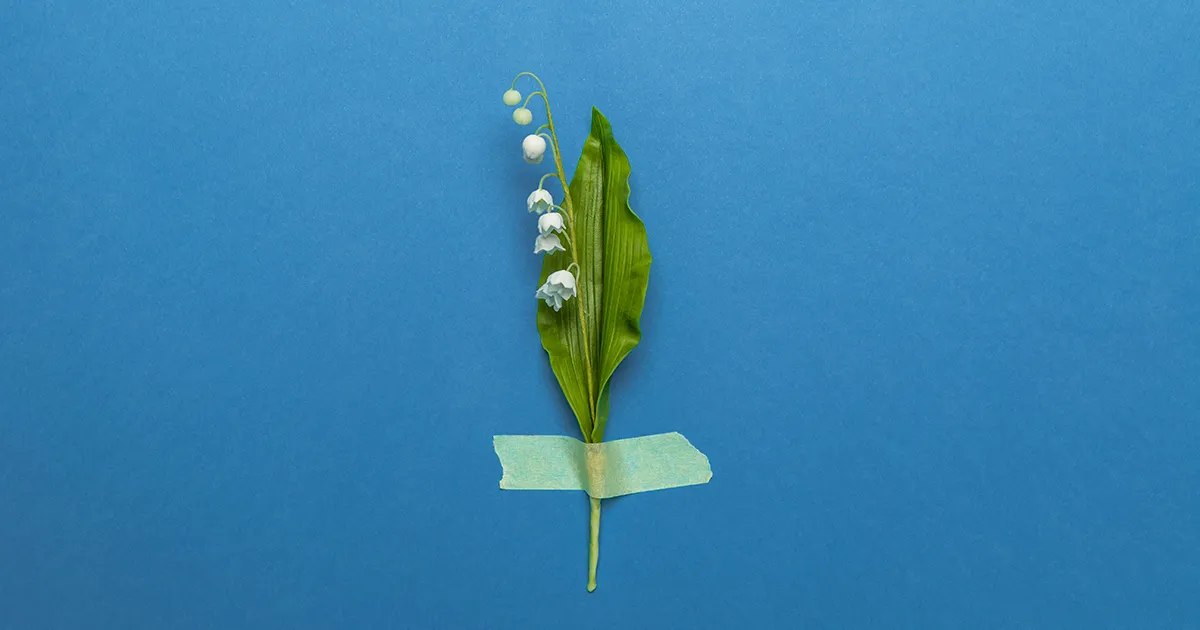



Pas de commentaires
Laisser un commentaire Cancel